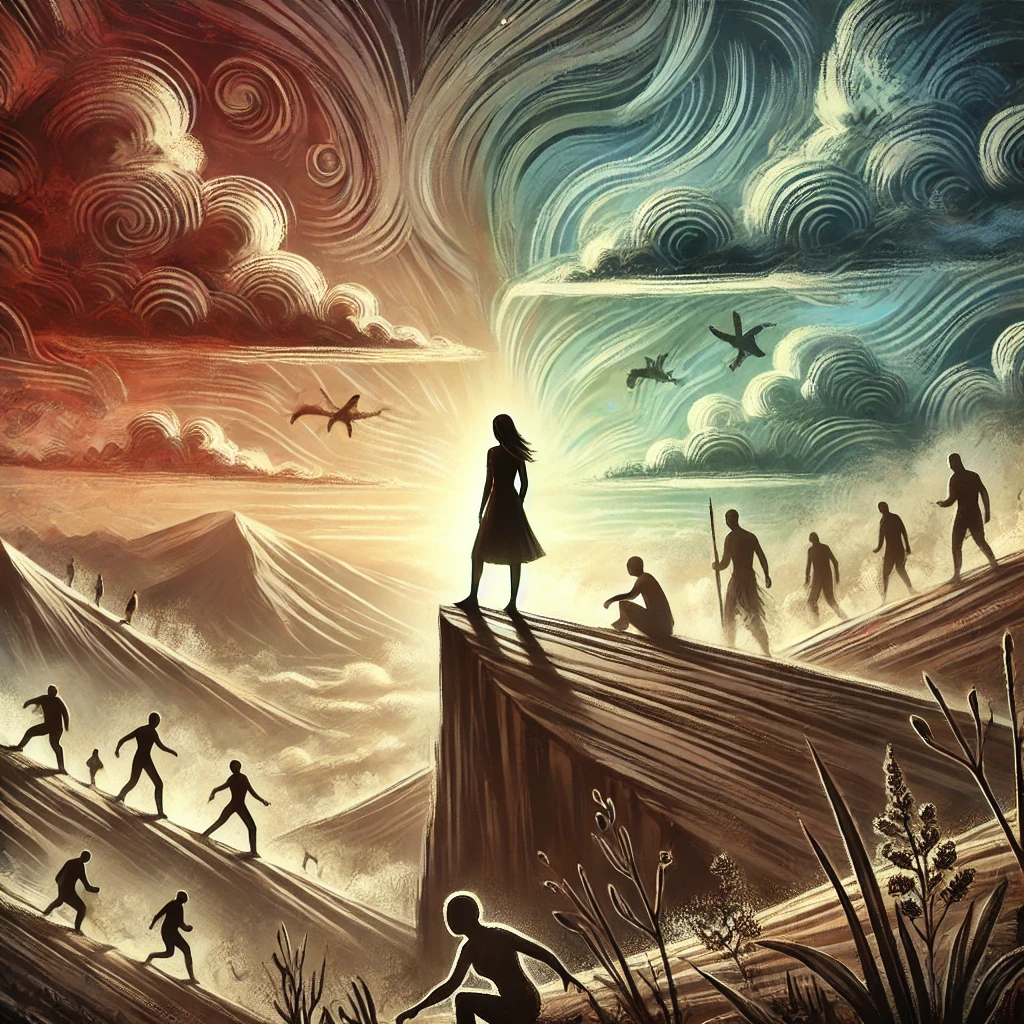Aujourd’hui j’aimerais partager une réflexion tirée d’une expérience récente vécue au cours de l’un de mes engagements bénévoles.
À mon retour des États-Unis, j’avais retrouvé un rythme de vie serein, éloignée des jeux de pouvoir organisationnels. J’ai alors été sollicitée par une amie pour intervenir dans une fédération en crise. J’ai hésité, consciente des risques d’une telle implication. Cependant, guidée par mon idéalisme et la volonté de défendre une cause importante—l’égalité professionnelle—j’ai finalement accepté ce défi.
Les premiers échanges furent positifs car trouver une présidente était devenue impossible pour cette fédération en perte de vitesse : la fédération internationale accueillit chaleureusement ma candidature car la fédération française était sur le point de fermer. La présidente de la Fédération française qui se plaignait de ne trouver personne pour la remplacer m’appela pour me proposer… la vice-présidence pendant un an avant de devenir présidente. Après réflexion, je déclinais sa proposition initiale car je voulais avoir les coudées franches pour redresser la situation. Ce fut la dernière fois qu’elle communiqua avec moi ! Le lendemain, je fus informée qu’elle avait changé d’avis et avait décidé de se représenter une troisième fois comme présidente, ce qui statutairement était d’ailleurs impossible.
Très vite, la situation a dégénéré suite à me demandes répétées d’éclaircissements et la réalité s’est imposée avec force au travers des entretiens avec les clubs : violation flagrante des statuts, effondrement alarmant des adhésions, fermeture en cascade des clubs, déficit financier majeur et manque total de transparence sur les actions entreprises. Les attaques personnelles de la présidente s’intensifièrent via l’une de ses vice-présidentes. La Fédération international dut s’en mêler pour l’obliger à partir et rendre des comptes. Ce qui aurait pu être une passation sereine s’est transformé en foire d’empoigne.
A la fin tout le monde a perdu : l’hémorragie des adhérentes a continué et la réputation de la présidente à qui j’avais proposé par deux fois un accord s’est effondrée. Evidemment la cause des femmes ne s’est pas trouvée mieux défendue.
Cette expérience à la fois riche et éprouvante m’a amenée à me poser plusieurs questions :
L’amitié en politique
D’abord, cette crise m’a permis de comprendre qui était véritablement un ami. J’avoue que je fus déçue malgré avoir travaillé longtemps dans les milieux politiques. Je savais que l’amitié véritable se dévoile justement dans les moments critiques, et qu’elle ne résiste que rarement aux calculs politique. Mais le vivre est une autre affaire. La déception et la colère fut grande. L’avantage est de savoir si qui compter surtout dans le cas de redressement d’une organisation. Elle m’a aussi rappelé qu’il est indispensable de rester vigilant sur les motivations réelles qui guident nos engagements, surtout lorsque ceux-ci se font au nom de valeurs nobles.

Femmes, pouvoir et jeux politiques
J’ai découvert dans ce contexte associatif un univers féminin où les luttes pour le pouvoir n’ont rien à envier à leurs homologues masculines. La quête du pouvoir qu’elle soit conduite par un homme ou une femme déclenche souvent rivalités, violences relationnelles et manœuvres stratégiques implacables, dans le cas cité exacerbées par une communication indirecte et toxique par email. Tous les coups seraient permis mais la violence verbale et physique masculine est remplacée par des actions dans l’ombre chez les femmes.
Je me suis alors demandé si la fin justifiait les moyens. Peut-être que cette femme poursuivait un but supérieur; mais comme je l’ai indiqué, il a été impossible de communiquer directement avec elle. Je pense que la recherche du bien commun pourrait justifier le recours à la violence. Mais qui définit alors le bien commun ? ce prétexte a historiquement entrainé bine des abus et des guerres.
Nietzsche nous rappelle également que « toute vie est volonté de puissance. » En effet, ces rivalités associatives illustrent clairement cette volonté universelle de dominer, d’exercer un contrôle, souvent au détriment de l’intérêt commun. Cette réalité interroge profondément le sens même de nos engagements : sont-ils motivés par une quête sincère de transformation positive, ou masquent-ils des ambitions personnelles cachées ?
Engagement sociétal, destinée et liberté
Face à ces défis, la notion de destinée m’a aussi profondément questionnée. Suis-je impliquée dans cette situation par hasard ou cela fait-il partie d’une mission que j’aurais à accomplir. Jean-Paul Sartre affirme : « Nous sommes nos choix. » Ainsi, en acceptant ce rôle, j’ai consciemment assumé les responsabilités et les difficultés qui en découlent. Ce choix révèle une tension permanente entre l’envie d’agir pour changer les choses et le désir naturel d’une vie plus tranquille, moins exposée aux conflits humains.
Sénèque souligne cette dynamique en affirmant : « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, mais parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. » C’est précisément dans cet esprit que j’ai choisi d’agir, consciente que chaque défi porte en lui une opportunité d’évolution personnelle.
Mais cela ne répond pas à la question de la destinée. Comme je l’ai exposée dans plusieurs de mes livres, notre personnalité primaire définit notre chemin de vie. Celle-ci est immuable et provoque des situations, permettant à notre identité de s’affiner au rythme des épreuves ou des joies, au cours des cycles de vie.
La quête de sens selon Camus
Face aux difficultés rencontrées dans cette fédération, je me suis aussi interrogée sur le sens profond de mes actions. Albert Camus, dans Le Mythe de Sisyphe, nous rappelle que : « Il faut imaginer Sisyphe heureux. » Autrement dit, face à l’absurdité ou la dureté de certaines luttes, notre responsabilité est d’y trouver un sens personnel qui nous permette de persévérer avec dignité et courage.
Cette quête du sens m’a permis de mieux me comprendre et de retrouver certaines de mes valeurs fondamentales : dépassement de soi, la fidélité à la parole donnée (avec comme corollaire la difficulté à accepter ceux qui ne la respectent pas) et la transparence. En comparaison, la recherche de reconnaissance personnelle ou de pouvoir m’apparait comme jeu futile et parfois méprisable bien que nécessaire car c’est ainsi que fonctionnent les sociétés humaines. Dépasserons-nous un jour cet aspect ontologique de l’être humain ?
Conclusion : une expérience initiatique
En fin de compte, cette aventure associative, bien que difficile, fut particulièrement riche en enseignements. Elle m’a confrontée à mes propres limites, à mes peurs et à mes valeurs essentielles. Elle m’a aussi permis de mieux comprendre les mécanismes humains liés au pouvoir et à l’amitié, tout en approfondissant ma réflexion sur la destinée et la liberté individuelle. Jean-Paul Sartre l’exprime parfaitement : « L’important n’est pas ce qu’on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu’on a fait de nous. ».
Cette expérience m’a aussi appris l’importance fondamentale de rester fidèle à ses valeurs personnelles et essentielles. J’ai également pris conscience qu’il est essentiel de rester lucide face aux jeux de pouvoir et aux manipulations relationnelles. Si j’ai parfois eu l’impression de m’égarer, chaque étape de cette aventure m’a permis de mieux me connaître, d’affirmer davantage mes convictions et surtout d’apprendre à discerner rapidement l’authenticité des intentions d’autrui. C’est précisément dans ces moments d’épreuve que nous grandissons, en prenant conscience de nos limites autant que de nos forces. Cette prise de conscience constitue l’une des richesses inestimables d’une telle expérience.
J’espère sincèrement que cette réflexion, nourrie d’expériences vécues et d’éclairages philosophiques, inspirera celles et ceux qui, comme moi, cherchent à agir dans la complexité du monde associatif tout en restant fidèles à leurs valeurs fondamentales.